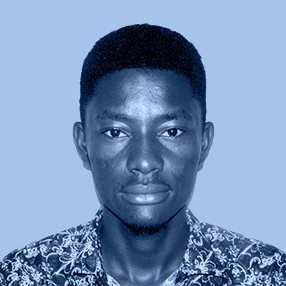Archives : Doctorants (doctorant)
Aurélien Catros
Aurélien Catros est architecte HMONP diplômé de l'École d'Architecture de Lyon. Il travaille d’abord aux côtés d’architectes du patrimoine, en France, avant d’entreprendre une thèse de doctorat à l’Université de Montréal sous la direction de Jean-Pierre Chupin et Bechara Helal. Titre du projet de thèse : "Transferts réciproques entre maquettes physiques et modèles numériques dans ... Lire la suite
Aristofanis Soulikias
Aristofanis Soulikias is an architect and film animator. He is a PhD student at Concordia University, in the Individualized Program (INDI), under the supervision of Dr. Carmela Cucuzzella, Dr. Cynthia Hammond and Prof. Luigi Allemano, pursuing an interdisciplinary research-creation study with the title: Architecture and Film Animation: Visualizing and educating on the built environment through ... Lire la suite
Alexandra Paré
Alexandra est présentement doctorante dans le programme de Ph.D. individualisé en architecture de l’Université de Montréal sous la direction de Jean-Pierre Chupin au Laboratoire d’étude de l’architecture potentielle. Elle détient une maitrise en aménagement de l’Université de Montréal et un baccalauréat en design de l’environnement de l’UQAM. Elle est également titulaire d’un baccalauréat en éducation ... Lire la suite
Mandana Bafghinia
Mandana Bafghinia est architecte et plasticienne. Elle est doctorante en co-tutelle entre le Canada et la France. Au Canada, sous la direction de Jean-Pierre Chupin dans le programme de doctorat individualisé en architecture de l’Université de Montréal au laboratoire LEAP, depuis septembre 2016. En France, sous la direction de Christian Montès et Manuel Appert, à ... Lire la suite