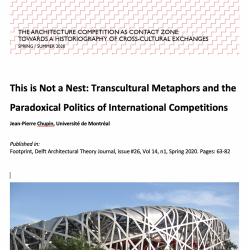Les 5 concours du LABécole entièrement documentés en exclusivité sur le CCC
Dans le cadre d’une collaboration avec l’organisme LABécole, le Catalogue des Concours Canadiens livre en primeur l’intégralité des 160 projets soumis en 2019 aux 5 concours pour la construction ou l’agrandissement d’écoles primaires à Shefford, Rimouski, Gatineau, Maskinongé et Saguenay. Le dévoilement officiel des lauréats ayant eu lieu lundi 24 août. S’il vous plaît, dessine-moi ... Lire la suite