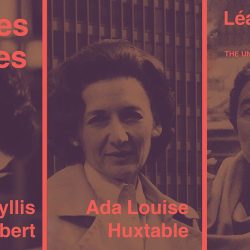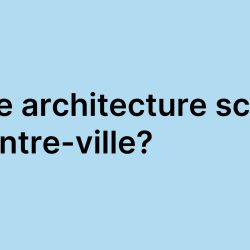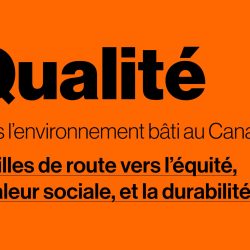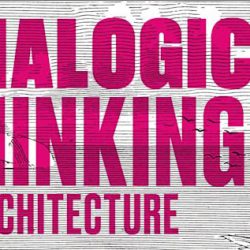Le programme final de la convention 2025 à Toronto est maintenant disponible !
Programme de la convention TORONTO 2025 : Vers un livre blanc sur la qualité... TÉLÉCHARGER LE PROGRAMME EN VERSION PDF Le programme final de la convention annuelle 2025 est maintenant disponible. Du 30 avril au 2 mai à Toronto, cet événement réunira des experts, des chercheurs et des praticiens afin de faire progresser une stratégie ... Lire la suite