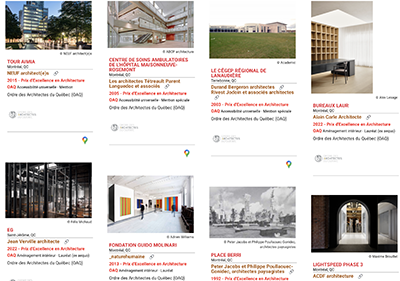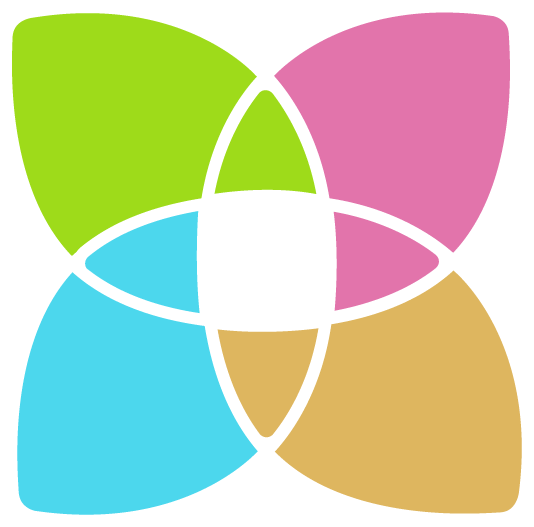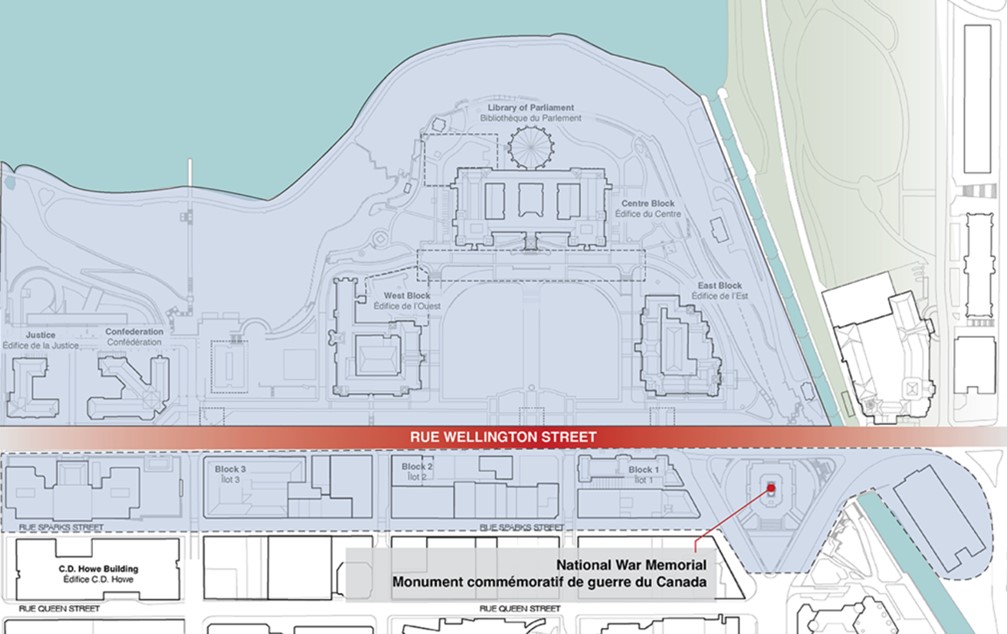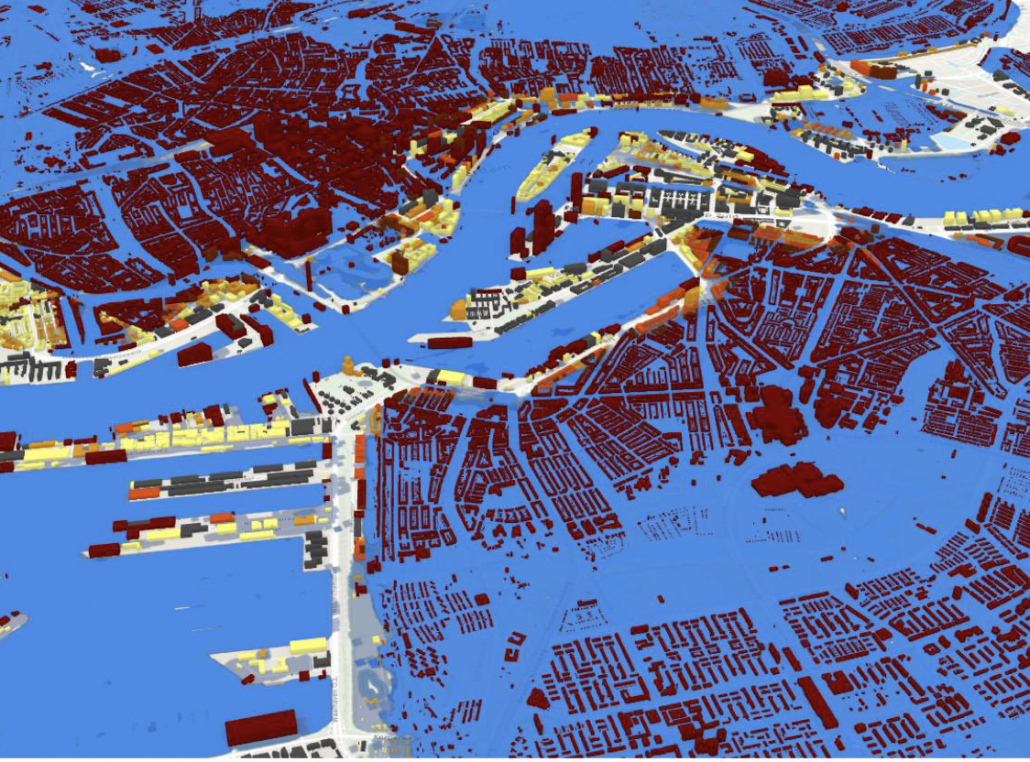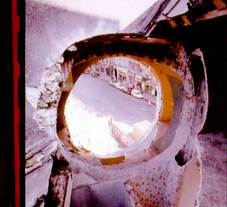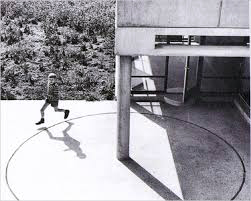VIVRE LA QUALITÉ AU QUOTIDIEN
2023-2025 – Jean-Pierre Chupin, Carmela Cucuzzella et Bechara Helal signent une convention de recherche avec la Ville de Montréal pour le projet : « Vivre la qualité au quotidien : Protocole d’enquête et d’évaluation qualitative de la valeur sociale des édifices publics par le recueil d’expériences vécues par les usagers ». Bureau du design. Convention de recherche. Organisme subventionnaire : Ville de Montréal (65 000$)